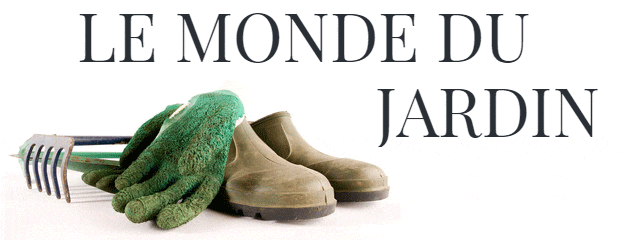Le glyphosate, un herbicide largement utilisé dans l’agriculture et les jardins, a fait l’objet de nombreuses controverses en raison de ses effets potentiels sur l’environnement et la santé humaine. Mais qu’en est-il de sa situation en Espagne ? Est-il interdit ou encore autorisé ? Cet article, destiné à un public professionnel, a pour objectif d’apporter des informations claires et précises sur le sujet.
L’état actuel de la réglementation sur le glyphosate en Espagne
En Espagne, la réglementation sur l’utilisation du glyphosate a été modifiée à plusieurs reprises, en réponse aux préoccupations croissantes concernant ses effets potentiels sur l’environnement et la santé publique. Le pays s’est engagé à respecter les décisions prises au niveau européen et a adapté ses propres législations en conséquence.
Les décisions au niveau européen
Au niveau européen, l’Union Européenne (UE) a renouvelé l’autorisation du glyphosate pour une période de cinq ans en 2017, malgré les controverses entourant cette substance. Toutefois, dans le cadre de la stratégie Farm to Fork (de la ferme à la table) adoptée en 2020, l’UE a annoncé son intention de réduire de 50% l’utilisation des pesticides chimiques d’ici 2030. Le glyphosate, en tant que pesticide, est concerné par cette stratégie.
Les mesures prises en Espagne
En Espagne, bien que le glyphosate ne soit pas totalement interdit, des restrictions ont été mises en place pour limiter son utilisation. En effet, depuis 2018, l’usage du glyphosate est interdit dans les parcs publics, les jardins, les espaces verts et les écoles. De plus, le gouvernement a approuvé un plan visant à réduire progressivement l’utilisation du glyphosate dans l’agriculture, avec pour objectif de favoriser l’adoption de méthodes alternatives moins nocives pour l’environnement et la santé humaine.
Les alternatives au glyphosate en Espagne
Face aux restrictions sur l’utilisation du glyphosate, les professionnels espagnols ont commencé à explorer des alternatives pour le désherbage et la gestion des cultures. Ces alternatives sont encouragées par le gouvernement et les organismes de recherche, qui soutiennent le développement de nouvelles technologies et de méthodes plus durables.
Les méthodes mécaniques et manuelles
Parmi les alternatives au glyphosate, les méthodes mécaniques et manuelles sont privilégiées, car elles permettent de contrôler les mauvaises herbes sans avoir recours à des substances chimiques. Ces méthodes incluent le labour, le désherbage manuel, le paillage et l’utilisation de bâches pour empêcher la germination des semences indésirables.
Les méthodes biologiques
En plus des méthodes mécaniques et manuelles, les professionnels espagnols peuvent également opter pour des méthodes biologiques de lutte contre les mauvaises herbes. Cela consiste à utiliser des organismes vivants (insectes, champignons, bactéries) ou des substances naturelles (extraits de plantes, micro-organismes) pour contrôler la croissance des plantes indésirables.
Les défis à relever pour une agriculture sans glyphosate
Bien que des alternatives existent et que des efforts soient faits pour réduire l’utilisation du glyphosate en Espagne, plusieurs défis demeurent pour parvenir à une agriculture totalement exempte de cet herbicide.
La résistance des mauvaises herbes
L’un des principaux défis est la résistance des mauvaises herbes aux méthodes alternatives. Certaines espèces ont développé une résistance aux herbicides chimiques, rendant les alternatives moins efficaces. Il est donc crucial d’investir dans la recherche et le développement de nouvelles méthodes de lutte contre les mauvaises herbes, afin de garantir une agriculture durable et respectueuse de l’environnement.
La formation des agriculteurs
Un autre défi important est la nécessité de former les agriculteurs à l’utilisation des alternatives au glyphosate, ainsi qu’à la gestion intégrée des mauvaises herbes. Cela implique de les informer sur les méthodes disponibles, leur efficacité et leur impact sur l’environnement, et de les encourager à expérimenter de nouvelles approches pour garantir la durabilité de leurs exploitations.
Pour finir, bien que le glyphosate ne soit pas totalement interdit en Espagne, des restrictions ont été mises en place pour limiter son utilisation, et des alternatives sont encouragées au sein du pays. Les professionnels espagnols sont incités à adopter des méthodes plus durables et respectueuses de l’environnement pour la gestion des cultures et le désherbage. Toutefois, des défis subsistent pour parvenir à une agriculture sans glyphosate, et il est essentiel de poursuivre les efforts de recherche et de formation pour un futur plus respectueux de l’environnement et de la santé humaine.
Surveillance, résidus et transition technique : éléments complémentaires
Au-delà des débats réglementaires et des méthodes de désherbage, il est indispensable d’intégrer des dispositifs de monitoring des résidus et d’évaluer l’impact sur le microbiome du sol et la faune auxiliaire. Des campagnes régulières d’analyses de sol et d’eaux de ruissellement (analytique ciblée par LC‑MS/MS ou bioessais) permettent d’estimer la bioconcentration et la persistance des molécules, ainsi que leur écotoxicité sur les communautés microbiennes, lombriciens et invertébrés pollinisateurs. Le recours à des bioindicateurs et à des protocoles de suivi à long terme favorise la traçabilité des pratiques culturales et la détection précoce de points noirs environnementaux, tout en alimentant des bases de données utiles pour l’évaluation des risques et la recherche appliquée.
Parallèlement, la transition vers des systèmes moins dépendants des herbicides peut être soutenue par des mesures de gestion du paysage : bandes tampons, couverture végétale permanente, agroforesterie et techniques de phytoremédiation pour accélérer la restauration des sols contaminés. Sur le plan économique et organisationnel, il est pertinent d’instaurer des mécanismes d’incitation, des outils de traçabilité et des aides à l’investissement pour l’acquisition d’équipements de semis-direct et de désherbage mécanique automatisé. Enfin, la mise en place de cahiers des charges basés sur des critères de qualité des sols et de biodiversité fonctionnelle, ainsi que des campagnes d’information technique et des services d’appui analytique, faciliteront l’adoption de pratiques résilientes. Pour des ressources pratiques et des retours d’expérience, on peut consulter le site web Le Jardin D’Helena.
Mesures complémentaires pour accompagner la transition
Au-delà des mesures déjà évoquées, il est utile d’intégrer des approches centrées sur la agroécologie et la gestion holistique des systèmes culturaux. La mise en place d’itinéraires techniques favorisant la rotation des cultures, l’introduction d’amendements organiques et le recours au compostage contribuent à améliorer la structure du sol, la disponibilité des nutriments et la santé racinaire. L’utilisation ciblée de mycorhizes ou d’inoculants rhizosphériques peut renforcer l’absorption des éléments nutritifs et réduire la dépendance aux intrants externes, tandis que la valorisation des résidus de culture dans une logique d’économie circulaire soutient la fertilité durable et la séquestration du carbone sur le long terme.
Parallèlement, des outils et indicateurs nouveaux facilitent la prise de décision agronomique : la télédétection et l’imagerie multispectrale, les capteurs de terrain pour l’humidité et la conductivité, ou encore les tableaux de bord d’indicateurs agroécologiques permettent d’optimiser les itinéraires et d’anticiper les besoins en interventions. Le développement d’observatoires locaux et de plateformes d’échange entre conseillers et exploitants favorise l’expérimentation collective, la diffusion d’itinéraires performants et les dispositifs de soutien économique. Ces leviers — techniques, numériques et organisationnels — renforcent la résilience agronomique face aux aléas climatiques et aux contraintes phytosanitaires, tout en préservant les services écosystémiques essentiels.
Instruments économiques et innovations pour accélérer la sortie du glyphosate
Pour rendre la transition opérationnelle et soutenable, il est pertinent de mobiliser des leviers économiques complémentaires aux actions techniques. Des mécanismes tels que les paiements pour services écosystémiques, une écotaxe ciblée sur les intrants à fort risque et des subventions conditionnelles peuvent internaliser les coûts environnementaux et encourager les pratiques sobres en herbicides. L’intégration d’une analyse de cycle de vie (ACV) dans les cahiers des charges permettra de mesurer l’empreinte réelle des itinéraires techniques et d’orienter les aides vers les solutions les plus efficaces. Par ailleurs, la mise en place d’une assurance récolte indexée ou de dispositifs de mutualisation des risques réduit l’exposition financière des exploitations qui adoptent des itinéraires innovants, facilitant ainsi l’investissement initial nécessaire pour l’équipement et la formation.
Sur le plan opérationnel, il est utile de promouvoir des démonstrateurs régionaux et des plateformes d’innovation qui testent des approches peu répandues jusqu’ici : le désherbage thermique, les procédés accélérant la biodégradation des résidus ou les techniques visant à limiter la lixiviation des substances dans la matrice sol‑eau. La coopération entre exploitants via des coopératives d’équipement, le recours à des prêts verts et la création de circuits courts valorisant les produits issus de systèmes à faibles intrants génèrent des incitations de marché concrètes. Enfin, des modules de formation professionnelle axés sur la gestion des risques, la conception d’itinéraires et la gouvernance locale, couplés à des outils d’évaluation économique, permettent d’objectiver les bénéfices agronomiques et financiers de la réduction du glyphosate.