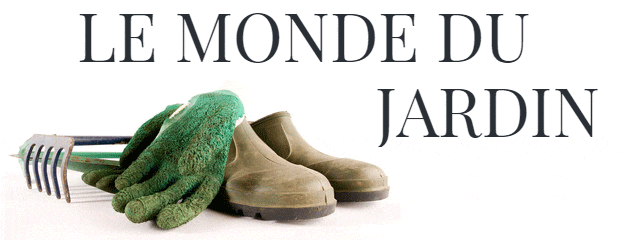Kalanchoe est une plante succulente originaire de Madagascar. Cette plante a de belles feuilles vertes et lisses, avec ou sans fleurs colorées, qui peuvent bien supporter la surchauffe interne et la sécheresse, c’est pourquoi il est toujours la seule plante d’intérieur de notre région. Une excellente façon d’apporter de la couleur et du vert dans la maison.
Le Kalanchoe ou kalanchoé est une fleur vivace qui peut être achetée dans de nombreux magasins de fleurs. La couleur est rouge, rose, jaune, blanc ou orange, et il en existe environ 120 sortes, la taille est d’environ 30 cm de hauteur, et pour les variétés plus exotiques, il peut atteindre 1 mètre.
N’essayez pas de le rendre impropre à l’environnement extérieur, car il ne peut pas résister à des températures inférieures à 10 °. Découvrez dans cet article, tout sur le kalanchoe.
Ce que vous devez savoir sur la plante succulente Kalanchoe
Le Kalanchoe est une plante qui apprécie la lumière et la chaleur. Il ne craint pas d’être exposé à la lumière directe du soleil et les rayons ne risquent pas de la brûler ! Sa plus grande faiblesse est l’excès d’eau, donc l’importance du drainage. En fait, ce dernier évitera la pourriture des racines lors de l’arrosage. Une couche d’argile ou de gravier au fond du pot peut résoudre le problème. Si les feuilles pourrissent à la base de la plante, réduisez immédiatement l’arrosage. Toutefois, elle a besoin de plus d’eau pendant la période de floraison.
L’entretien du Kalanchoe
Premièrement, le kalanchoe est sensible au climat doux, il est principalement destiné à l’intérieur de la maison, même s’il puisse pourtant être rempoté dans le jardin. Pendant la période de floraison de février à avril, retirez les fleurs mortes pour favoriser l’émergence de nouvelles fleurs. Ajoutez de l’engrais aux plantes à fleurs tous les 15 jours. Enfin, surtout pour apprécier la lumière, placez-la derrière la fenêtre. À partir de mai, une fois tous les risques de gel éliminés, jusqu’à fin septembre, placez le kalanchoe dans un endroit lumineux à l’extérieur et fertilisez toutes les 3 semaines. Puis, en hiver, il est recommandé de replanter les plantes pour favoriser la floraison et prolonger leur durée de vie. Pendant cette période, arrêtez d’ajouter de l’engrais. Si la cause principale au printemps est trop étroite, vous pouvez également la reconstituer au printemps. Enfin, les feuilles du kalanchoe sont toxiques, veillez à ne pas les mettre hors de portée des enfants et des animaux pour éviter leur ingestion. En fait, vous pouvez faire des branches coupées de kalanchoe automne, en planter de nouveau les extrémités des tiges dans du terreau.
Arrosage de cette plante succulente
Le kalanchoe doit être arrosé immédiatement après le séchage du sol. Durant la floraison, cela se fait deux fois par semaine. En dehors de cette période, irriguez tous les 5 jours environ. Enfin, en hiver, vous pouvez limiter la fréquence à une ou deux fois par mois. Dans tous les cas, l’arrosage est indispensable. Si les feuilles pourrissent à la racine de la fleur, la racine peut également être affectée. Réduisez ensuite la quantité d’eau ajoutée. Si les feuilles flétrissent et tombent, augmentez le nombre.
Soins complémentaires : substrat, hygrométrie et prévention
Au-delà de l’arrosage et de la lumière, la qualité du sol joue un rôle déterminant pour la vitalité du kalanchoe. Privilégiez un mélange aéré et drainant : un terreau horticole allégé avec perlite ou sable grossier permet une bonne oxygénation des racines et limite la rétention d’eau. L’ajout d’un amendement organique en petite quantité favorise la disponibilité des oligo-éléments sans alourdir le substrat. Pensez aussi au pH : une solution légèrement acide à neutre optimise l’assimilation des nutriments. Pour renforcer la santé racinaire, des inoculants microbiens (mycorhizes) peuvent améliorer la résistance aux stress hydriques et faciliter l’absorption minérale, surtout après un rempotage ou un changement de substrat.
La gestion de la hygrométrie et du microclimat intérieur fait souvent la différence entre une plante ordinaire et une plante florifère. Assurez une circulation d’air régulière pour éviter la stagnation d’humidité qui favorise moisissures et ravageurs. Inspectez régulièrement les feuilles et l’envers des nervures : cochenilles et araignées rouges peuvent apparaître discrètement — un contrôle manuel, une pulvérisation d’eau savonneuse ou un nettoyage à l’alcool dilué sont des méthodes efficaces et naturelles. En cas de carences visibles malgré un sol adapté, une fertilisation foliaire ponctuelle peut corriger rapidement les déficits en micronutriments. Pour des conseils pratiques et des fiches techniques sur l’entretien, la composition des substrats et la lutte intégrée contre les parasites, consultez Le Monde du Jardin, qui propose des ressources complémentaires pour affiner vos pratiques de jardinage en intérieur.
Techniques avancées : propagation et maîtrise de la floraison
Outre les soins courants, l’apprentissage de quelques techniques de multiplication permet d’accroître votre collection sans acheter de nouvelles plantes. Le bouturage foliaire ou de tige est simple : laissez cicatriser la coupe à l’air plusieurs jours avant de l’installer dans un substrat léger pour favoriser l’apparition de racines. Le marcottage aérien peut être employé pour obtenir une section déjà enracinée sans séparer immédiatement la plante-mère. Pour optimiser les chances d’enracinement, veillez à utiliser des outils stériles, évitez l’excès d’humidité en surface et, si besoin, appliquez quelques traces d’hormone d’enracinement à base d’auxine sur le point de coupe. La patience est essentielle : le temps d’installation varie selon la saison et la vitalité de la plante, mais un bon enracinement garantit une reprise rapide et une meilleure résistance aux stress ultérieurs.
Pour les amateurs souhaitant piloter la floraison, la photopériode et la dormance sont des leviers puissants. Certaines variétés réagissent à la durée du jour : réduire progressivement la lumière en soirée pendant plusieurs semaines peut déclencher la mise à fleur. De même, des nuits légèrement plus fraîches favorisent la differentiation des boutons, à condition de ne pas descendre sous la température critique. Surveillez aussi les signes physiologiques non liés aux ravageurs, tels que l’étiolation (allongement des tiges en recherche de lumière) ou la chlorose (jaunissement dû à un déséquilibre minéral), qui indiquent que l’exposition ou la nutrition doivent être ajustées.